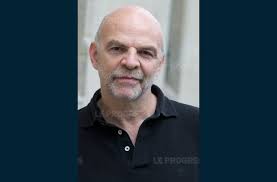ÉTATS-UNIS / MEXIQUE

Ed Lacy (pseudonyme de Leonard Zinberg, est né à New York en 1911. Auteur de nouvelles puis de romans policiers, il est un auteur engagé aux côtés des Noirs et contre toute forme de guerre, celle du Vietnam en particulier. Il est mort dans le quartier d’Harlem en 1968.
La mort du toréro
1964 / 2024
Après un séjour forcé en Europe et en Afrique du Nord, pendant la 2ème Guerre mondiale et une première enquête[1] Toussaint Moore, lassé d’aventures, est postier à New York, postier et dépressif. L’annonce d’un prochain bébé dans le couple qu’il forme avec Fran qu’elle lui annonce brusquement le plonge dans un désarroi moral et matériel. L’occasion de gagner un peu d’argent pour subvenir au budget moribond se présente avec la proposition de Ted Bailey et de Kay Robbens, ses précédents « employeurs », une mission particulière à Mexico.
Arrivé dans une capitale où il n’a jamais mis les pieds, perdu par une langue qu’il ne parle pas, ce Noir très noir compare le racisme omniprésent et très direct de New York et celui, plus sournois, du Mexique où les Indiens ne sont pas aussi mal traités que les gens de couleur du Nord mais souffrent autant quoique différemment.
La commanditaire est une veuve plus jeune que ce que croyait Toussaint, elle n’a qu’un grave défaut : elle « élève » des serpents venimeux chez elle et son mari est mort d’une piqûre de serpent.
La mort du toréro a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1964 et Mexico dans les années 60 ressemblait, malgré sa taille déjà impressionnante, à une ville provinciale, les voitures roulaient encore (depuis longtemps elles sont en permanence à l’arrêt, avançant de temps en temps de quelques mètres), les gens allaient et venaient sans se préoccuper d’une insécurité inexistante, le pire danger pour les habitants et les touristes était de se faire filouter par les chauffeurs de taxis. C’est cette ambiance que font ressortir les errances de Toussaint dans des rues animées et paisibles, dans l’ensemble : il sera bien au centre de règlements de comptes tout de même.
Les codes du polar classique sont bien présents : la mystérieuse veuve, la bimbo blonde (yankee) et un peu maigrelette, enfin bon, le privé fauché et noir, mais Ed Lacy sait les détourner pour qu’en même temps on se sente en pays de connaissance et en terrain assez nouveau pour intriguer avec, pour idée récurrente le racisme nord-américain, le Mexique compris.
Le rythme n’est pas effréné, le narrateur prend le temps de décrire une ville, un pays qui, c’était le cas pour une grande majorité de Nord-Américains, attiraient et qui piquaient leur curiosité, leur soif d’exotisme (à bas prix), et un des intérêts du roman, en plus de l’intrigue policière, est de retrouver New York, Mexico et Acapulco comme on a oublié qu’ils ont été, peut-être de comparer avec notre propre expérience et de retrouver ces images vintage tellement à la mode à présent. Et, surtout, on appréciera la façon dont Ed Lacy, ou Leonard Zinberg, le véritable nom de l’auteur, homme blanc, Juif et communiste, s’est glissé dans la peau d’un Noir quand la séparation était encore la règle sur le territoire nord-américain pour montrer directement le ressenti des gens de couleur qui dans les romans de l’époque, n’étaient généralement que des caricatures. Une curiosité et une réussite.
La mort du toréro, traduit de l’américainet préfacé par Roger Martin, éd. du Canoë, 250 p., 18 €.
[1] Traquenoir, éd. du Canoë et 10/18
MOTS CLES : ETATS-UNIS / MEXIQUE / POLAR / RACISME / VIOLENCE / HUMOUR / SOCIETES / EDITIONS DU CANOË.